La Sécurité sociale connaît une nouvelle dégradation record de ses comptes. En 2025, son déficit pourrait atteindre 23 milliards d’euros, contre 10,8 milliards en 2023. En deux ans, le déficit aura plus que doublé. Il se situe désormais - hors années exceptionnelles pendant la crise Covid - à son niveau le plus élevé observé depuis 2012, alerte la Cour des comptes dans son dernier rapport, publié le 3 novembre.
Pour les sages de la rue Cambon, ce dérapage brutal ne s’explique pas par une explosion des dépenses mais par un déséquilibre durable entre recettes et dépenses que les mesures d’économies, votées dans les dernières lois de financement, n’ont pas suffi à enrayer. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2026 prévoit un effort important avec 9 milliards d’euros d’économies et 2 milliards de recettes nouvelles, mais la Cour des comptes juge ce redressement « fragile ».
Surtout, elle alerte sur un risque croissant de liquidité. L’Acoss (1) - qui finance la trésorerie de la Sécurité sociale - devra emprunter jusqu’à 83 milliards d’euros en 2026. Un record. Selon les projections, ce besoin pourrait atteindre 135 milliards d’euros à l’horizon 2029 si aucune ressource pérenne ni reprise de dette par la Cades (2) n’est décidée. La Cour y voit une « perte de contrôle de la trajectoire des finances sociales », d’autant plus inquiétante qu’elle intervient en dehors de toute crise majeure, conclut-elle.
« Une insuffisance de financement plutôt qu’un déficit »
« Avant, la Sécurité sociale était financée par les cotisations sociales des employeurs et des salariés. Désormais, elle repose sur la CSG qui n’est plus une cotisation mais un impôt
Jean-Paul Domin, économiste et professeur à l’université de Reims Champagne-Ardenne
Derrière ces chiffres alarmants, c’est la question même de la pérennité du modèle de financement de la Sécurité sociale qui se pose, sachant que l’officine est dépendante pour 80 % de son chiffre d’affaires de cet organisme payeur. Pour Jean-Paul Domin, économiste et professeur à l’université de Reims Champagne-Ardenne, cette dérive des comptes n’a rien d’une surprise. « Il vaut mieux parler d’insuffisance de financement plutôt que de déficit », estime-t-il. Selon lui, le problème est structurel et profond, conséquence « d’un changement de logiciel » dans les années 1990. « Avant, la Sécurité sociale était financée par les cotisations sociales des employeurs et des salariés. Désormais, elle repose sur la CSG qui n’est plus une cotisation mais un impôt. » « Or la CSG n’est pas très efficace, notamment parce que ce système exonère tout un tas de revenus. Ces exonérations de CSG sont d’autant plus problématiques que le système n’arrive pas à se financer », affirme Jean-Paul Domin.
Autrement dit, le déficit de la Sécurité sociale ne vient pas d’une explosion des dépenses, mais d’une érosion programmée des recettes. « Quand la CSG a été mise en place, on savait d’ailleurs que ce mode de financement serait beaucoup moins performant que les cotisations. » Par ailleurs, « Le débat politique s’arc-boute sur la question du coût du travail, mais il faut toujours avoir à l’esprit qu’une population bien soignée, qui cotise, est une population qui produit mieux qu’une population sans soins. » D’où une interrogation de fond : le but est-il de faire des économies ou admet-on que la santé est un coût réel, à ne pas considérer comme un poste classique de dépenses ?
Reconnaître ce coût ne signifie pas pour autant renoncer à toute maîtrise des comptes, précise Jean-Paul Domin. « Il faut mieux réfléchir avant d’exonérer autant d’acteurs économiques du paiement de la CSG. » La solution, conclut l’économiste, n’est pas dans la compression des dépenses mais dans le rétablissement d’un financement juste et universel.
« Les économies sur le prix des médicaments ont atteint leurs limites »
« En France, environ 20 % des patients sont ALD, c’est énorme. Et c’est justement là que le pharmacien a un rôle clé à jouer
Thomas Morgenroth, économiste de la santé et pharmacien
Pour Thomas Morgenroth, économiste de la santé et pharmacien, le constat est le même : la Sécurité sociale traverse une crise structurelle. La question n’est plus de savoir si elle peut tenir dans sa forme actuelle, mais comment la faire évoluer. « Les chiffres parlent d’eux-mêmes, le déficit se creuse et il y a nécessité à rééquilibrer les comptes », observe-t-il. Pendant des années, l’ajustement s’est fait sur le prix du médicament mais cette politique a aujourd’hui atteint ses limites. « Il faut bien reconnaître que cela devient difficile car les produits récemment arrivés sur le marché sont de plus en plus onéreux, en particulier les thérapies innovantes », souligne-t-il. Pourtant, la part du médicament dans les dépenses de santé n’augmente pas. Autrement dit, le médicament n’est plus la « variable miracle » capable d’équilibrer les comptes.
Si les marges de manœuvre sur les prix sont désormais limitées, l’un des principaux leviers pour maîtriser les dépenses de l’assurance-maladie réside aujourd’hui dans la prévention et l’accompagnement des maladies chroniques. « En France, environ 20 % des patients sont en affection de longue durée (ALD), c’est énorme. Et c’est justement là que le pharmacien a un rôle clé à jouer », analyse Thomas Morgenroth.
Dès le diagnostic, voire avant l’apparition des premiers symptômes, le pharmacien peut contribuer à prévenir les complications, à renforcer l’observance et à sécuriser le parcours de soins. « Une meilleure prévention par l’action du pharmacien sera source d’économies pour l’assurance-maladie, tout en améliorant la prise en charge des patients », analyse-t-il.
Pour une refonte du modèle de rémunération des pharmaciens
En outre, cette évolution apparaît dans un moment charnière pour la profession. « Nous vivons une phase où le modèle officinal est en train de se réinventer », estime Thomas Morgenroth. « La déconnexion de la rémunération du pharmacien par rapport aux marges issues de la vente du médicament permettra peut-être d’orienter les professionnels vers de nouvelles missions, cohérentes avec les objectifs d’économies de la Sécurité sociale. »
La réflexion n’est pas théorique et la mission flash IGAS-IGF, lancée début novembre, explore notamment cette piste. « Il ne s’agit pas d’inventer un nouveau système, mais de poursuivre ce qui a déjà été amorcé », explique-t-il. Vaccination, bilans de prévention, les nouvelles missions se multiplient. « Toutefois, leur intégration dans le quotidien des officines reste encore timide malgré de fortes progressions. »
Quelles formes ce nouveau mode de financement pourrait-il prendre ? « On peut imaginer une politique volontariste en y incluant les pharmaciens pour qu’ils puissent orienter une partie de leurs actes sur cette prévention », développe Thomas Morgenroth. « Pourquoi ne pas ouvrir également à un cofinancement ? Je pense notamment au soutien de la protection complémentaire qui aurait toute sa place sur ce volet prévention », ajoute-t-il.
Si le constat est alarmant, les deux économistes soulignent que la survie de la Sécurité sociale dépendra moins d’une réduction des dépenses que de la capacité à repenser profondément son mode de financement.
Sylvain Labaune
(1) Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss)
(2) Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades)

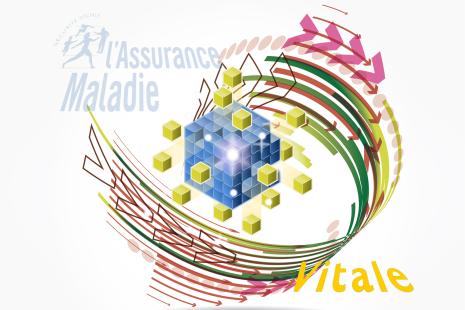
PLFSS 2026
Stéphanie Rist : « Le réseau France Santé doit garantir une consultation médicale dans les 48 heures, à moins de 30 minutes de chez soi »
Lutte contre le gaspillage
Généralisation de la dispensation à l’unité : une bonne idée, vraiment ?
Initiatives
Comment j’ai…fait face aux conséquences d’un incendie
Justice
Exit les médicaments à prescription obligatoire sur le site de Livmed’s